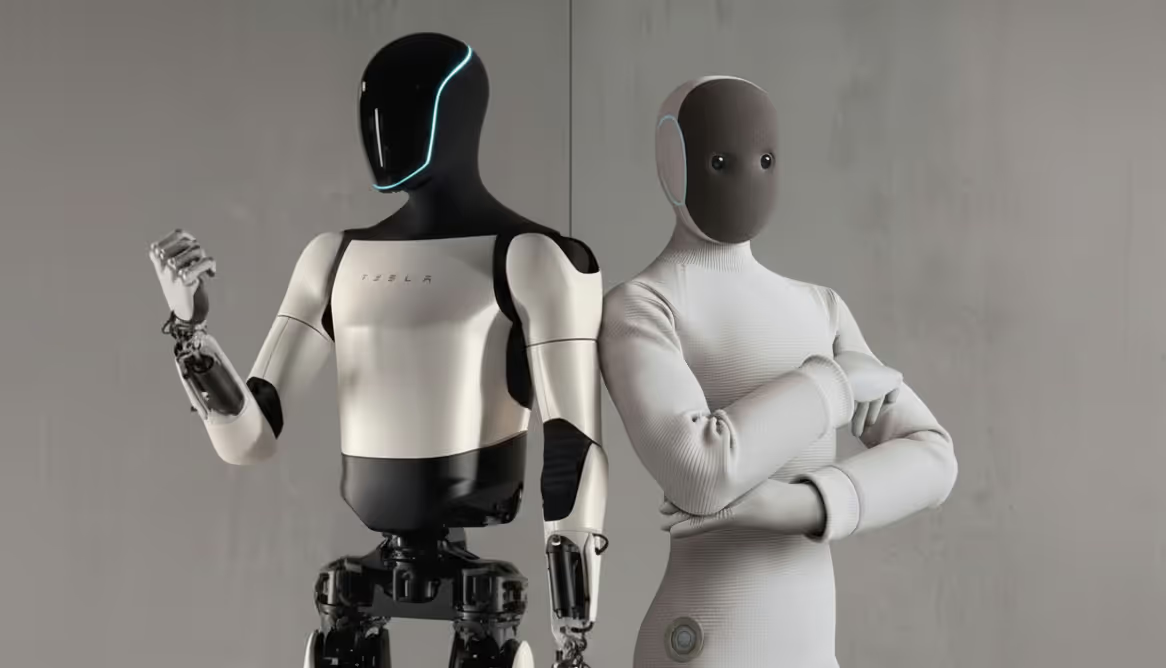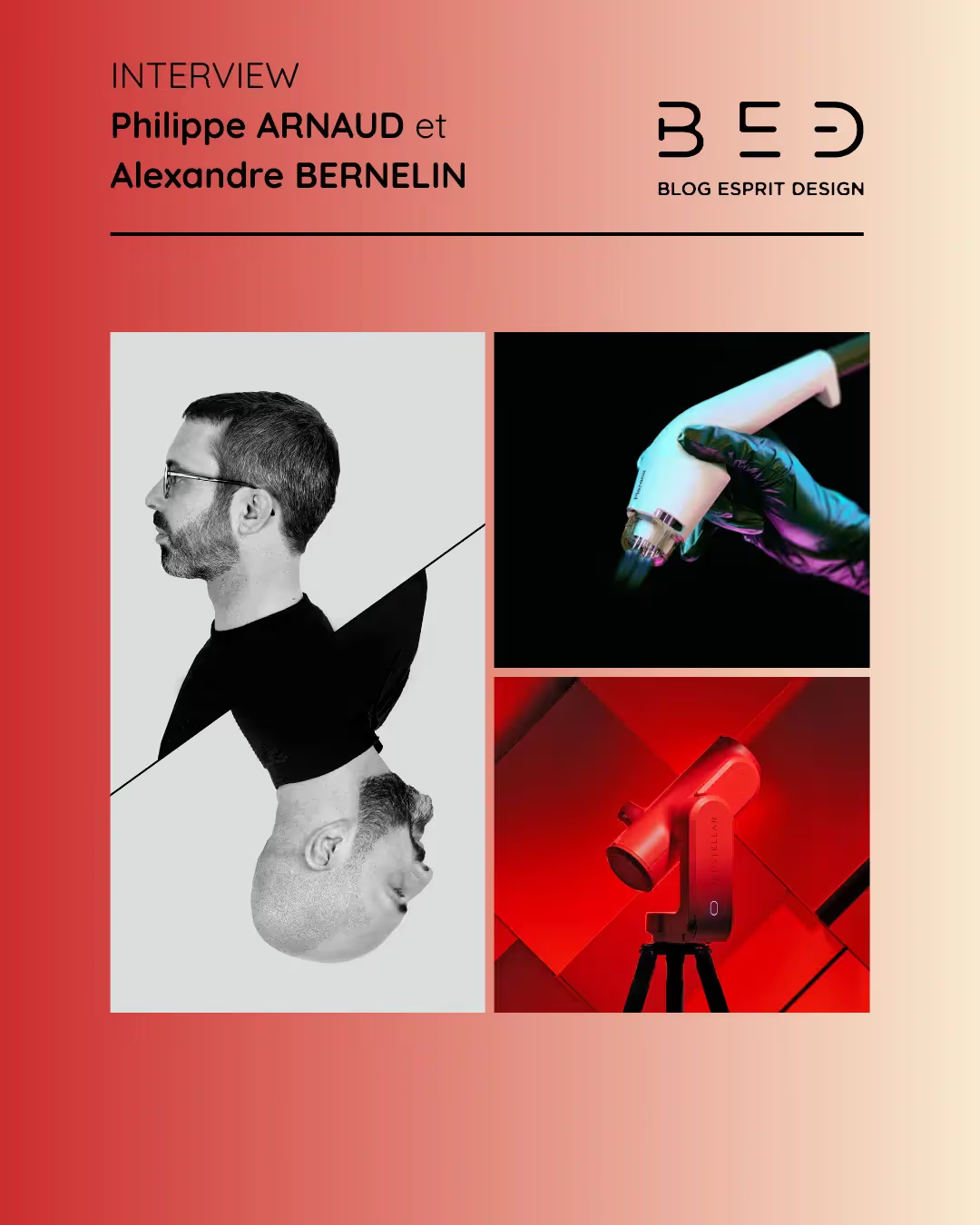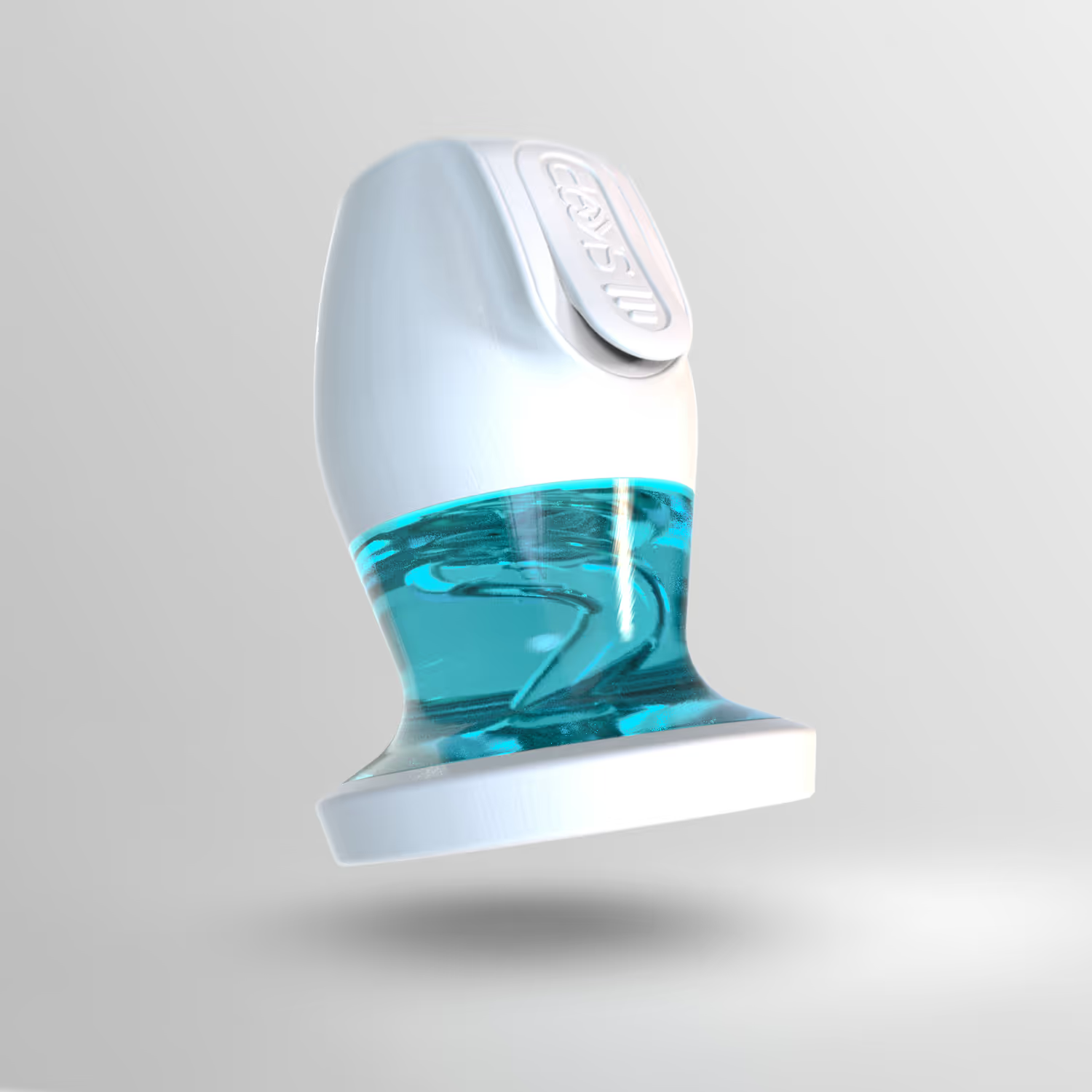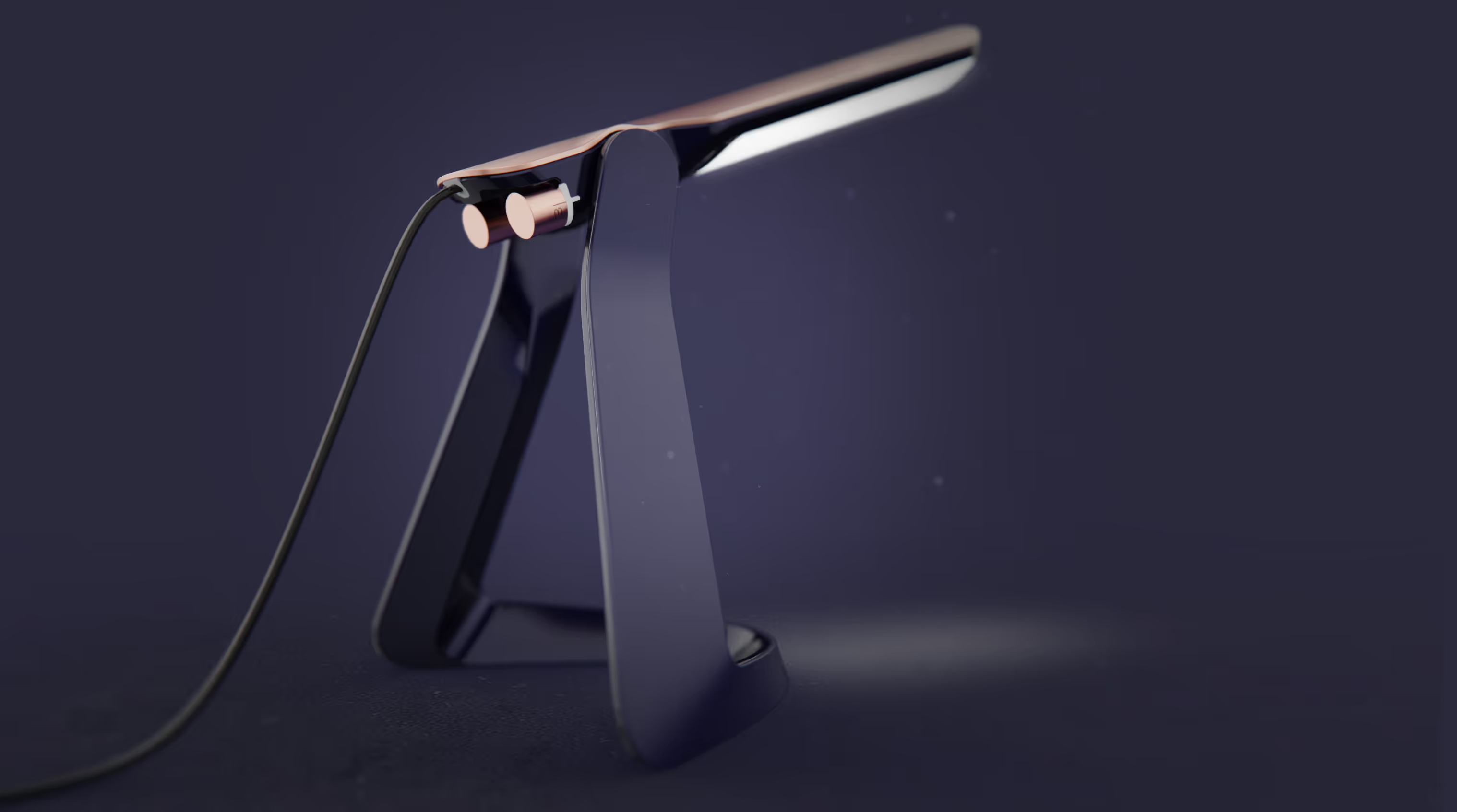L’architecture du choix à l’ère de l’IA
Note — Ce texte est issu d’une conférence tenue lors de la France Design Week, dans le cadre d’un événement de l’Agence de l’Innovation de Défense (DGA). Il développe une thèse simple : à l’ère des génératives, éditorialiser les données d’entraînement permet de transformer le brief en spécifications computationnelles, de mettre l’IA à sa main et, in fine, de spécifier autrement.
Éditorialiser les données d’entraînement pour mettre l’IA “à sa main”
Générer n’est pas décider. Les IA génératives compressent le temps de matérialisation (rendus, 3D, variantes). Le gain est réel : moins de temps pour produire, plus de temps pour choisir. Mais choisir quoi, sur quelle base, et pourquoi ?

Données généralistes ⇒ résultats imprécis
Par défaut, une IA entraînée sur des corpus généralistes renvoie une SORTIE STATISTIQUEMENT PROBABLE : correcte en moyenne, imprécise dans le détail.
l’IA encode des corrélations apprises dans ses données d’entraînement ; hors domaine, elle recombine l’habituel plutôt qu’elle n’atteint la justesse contextuelle.
Conclusion : si l’on veut de la justesse, il faut donner de la matière utile à la machine, pas seulement des prompts.
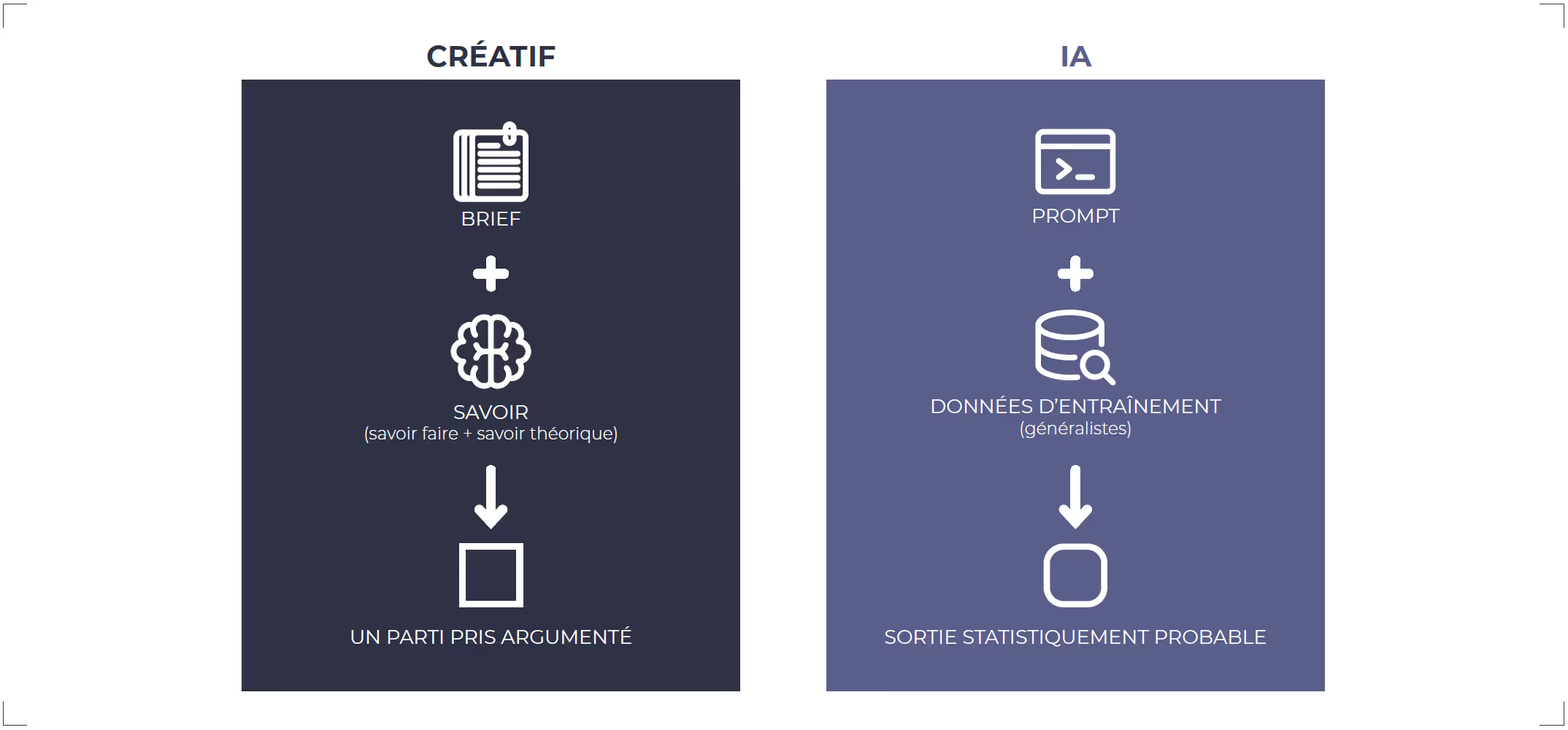
Ajouter de la donnée… oui, mais éditorialisée
“Plus de données” ne suffit pas. Il faut éditorialiser les données d’entraînement (ou d’adaptation) :
- Provenance & droits : sources, licences, consentements, souveraineté.
- Qualité & couverture : contextes, edge cases, fraîcheur ; signal/bruit.
- Annotation & biais : schéma de labels, équité par sous-populations.
- Traçabilité : lineage, versions, journalisation, contrôles de dérive.
Trois voies complémentaires pour exploiter cette matière :
- Fine-tuning / Domain adaptation : spécialiser le modèle avec des exemples représentatifs du projet.
- RAG (Retrieval-Augmented Generation) : brancher la génération sur un index documentaire dédié au périmètre.
- Évaluations dédiées (EVAL) : mesurer l’effet réel (labo et terrain) pour éviter l’illusion de progrès.
Faire de l’IA un outil à sa main
Éditorialiser la donnée transforme un brief techno/marketing en brief design computationnel — lisible par la machine et utile au métier :
- Critères calculables (unités, seuils, méthodes de mesure)
- Jeux de test indépendants de l’entraînement
- Données d’entrée prêtes pour l’IA et compréhensibles par les équipes
On ne demande plus « fais joli », mais « respecte ces critères, atteins ces seuils, prouve-les ainsi ».
Le design redevient architecture du choix : du rendu à un verdict explicable.
En pratique : comparer, puis valider
Comparer (évaluer des options)
- Métriques d’usage : temps-à-tâche, erreurs, compréhension au 1er coup d’œil, accessibilité, coût.
- Pondérations transparentes : scorecard multi-critères (poids assumés).
- Labo + terrain : mêmes métriques en environnement contrôlé et en contexte réel.
- Évidence jointe : captures, logs, A/B, jeux EVAL séparés de l’entraînement.
Valider (go / no-go)
- Tests d’acceptation : pass/fail (normes, risques).
- Robustesse & non-régression : variabilité de contexte, stabilité dans le temps.
- Niveau de confiance : tailles d’échantillon, IC/p-value, MDE.
- Traçabilité : specs-as-code, decision log (qui, quoi, quand, pourquoi).
Défense : le besoin d’en connaître, la donnée terrain et la “régurgitation”
Dans la défense, le besoin d’en connaître impose une règle simple : une IA ne doit voir que les données nécessaires au périmètre du projet.
- La donnée terrain est cruciale (réalité d’usage), mais classifiée : collecte cadrée, anonymisation, journalisation, cloisonnement.
- Les accréditations ne suffisent pas à éviter la régurgitation d’un projet vers un autre si l’on mélange les corpus.
- Recommandation : adopter des modèles (ou adaptateurs) et/ou index RAG par projet, avec politiques de non-contamination (espaces de noms séparés, interdiction de ré-entraînement croisé, rétention zéro hors périmètre).
Objectif : garantir le besoin d’en connaître, réduire les fuites potentielles et empêcher l’“effet perroquet” de projet en projet.






À retenir
- Une IA généraliste produit une SORTIE STATISTIQUEMENT PROBABLE ; pour la justesse, éditorialisez les données d’entraînement.
- L’IA encode des corrélations : fournissez-lui des corrélations pertinentes (métier, terrain, cas limites) et des tests qui comptent.
- Éditorialiser = transformer le brief en spécifications computationnelles ; c’est ainsi qu’on met l’IA “à sa main”.
- En défense, le besoin d’en connaître et le risque de régurgitation imposent un cloisonnement fort : un modèle/adaptateur et/ou un index RAG par projet, pas de mélange.